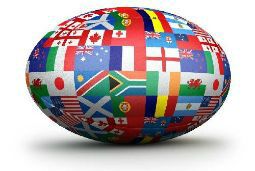Très perturbée par la disparition de personnes à certains postes (« petits » péages, standards de certaines entreprises ou administrations…) ou par la « voie de disparition » nettement imposée à d’autres (postes santé dans les écoles, caisses dans les supermarchés…), je me lance dans une petite série d’articles pour traiter le sujet avec vous, si ça vous dit …
A peine avais-je commencé à rédiger l’article sur la disparition des personnes dans les péages de ma région (Lunel, Gallargues-le-Montueux, Nîmes / Garons…) que je me suis retrouvée confrontée à la possibilité d’une vaste réflexion sur le sujet. Parce que tout de suite, je me suis imaginé qu’on pouvait me répondre que travailler dans une cabine en sortie d’autoroute, en soi, c’était pas un travail très sympa, très glorifiant ni même super bien payé … bref, un travail de m**
Je commence ma réflexion en retraçant l’histoire du mot « travail » ; je pense que c’est déjà très éclairant.
Ma source préférée quand je cherche l’origine d’un mot, c’est le Dictionnaire Historique de la Langue Française, en deux volumes, publié chez Robert sous la direction de Alain REY.
Voici donc une synthèse de ce que j’y ai lu à propos de « travail », qui d’ailleurs est apparu après le verbe « travailler »
travailler est issu (1080) du latin populaire tripaliare = tourmenter, torturer avec le trepalium (instrument de torture)
♣ en ancien français et toujours dans l’usage classique = faire souffrir, physiquement ou moralement / souffrir (XIIè siècle)
Il s’est appliqué spécialement à :
– un condamné que l’on torture (1155)
– à une femme dans les douleurs de l’enfantement (1175 ; seul le « travail » reste usité aujourd’hui dans les termes médicaux « salle de travail » et « femme en travail »)
– à une personne dans l’agonie (1190)
Tous ces emplois ont disparu.
Il a également signifié :
– molester quelqu’un (1249)
– endommager quelque chose (XVè siècle)
– battre quelqu’un (XVIIè siècle) (d’où l’expression « travailler au corps », apparu dans le milieu de la boxe au XXè siècle)
Il s’est aussi employé pour :
– agiter (l’eau d’un fleuve … 1270)
– être agité (1709) (valeur encore représentée dans l’expression « travailler du chapeau »)
Enfin, toute cette première valeur étymologique s’est conservée de manière affaiblie avec le sens de « tracasser, inquiéter » dans des expressions telles que « ça me travaille ».
Toute cette première partie ne me donne plus du tout envie d’utiliser ce terme pour parler de ceux qui exercent régulièrement une activité permettant de (sur)vivre, et ce dans la joie et l’épanouissement (oui, il y a des gens heureux de faire leur métier!! Mais s’ils sont heureux et épanouis, le sens premier de « torture / souffrance » ne peut s’appliquer). Mais elle éclaire aussi cruellement, parce qu’avec justesse, ce qu’est devenu le monde du travail au sens où nous l’entendons aujourd’hui, pour nombre de personnes, et où le tristement célèbre « travailler plus pour gagner plus » résonne comme ce désuet et cruel « il faut souffrir pour être belle »!
♣ Dès l’ancien français, plusieurs emplois impliquent l’idée de transformation acquise par la peine.
– « se travailler » (de 1155 jusqu’au milieu du XIXè siècle) signifie « faire de grands efforts »
– « travailler à » (1207) = faire tous ses efforts pour obtenir un résultat
Mais ces valeurs encore négatives sont supplantées à partir du XVIè siècle par l’idée de « transformation efficace ».
Le verbe se répand aux sens de :
– faire un ouvrage (1538) et « rendre plus utilisable« , d’abord à propos d’un ouvrage de l’esprit
– participer à l’exécution d’un ouvrage
! L’idée de travail professionnel apparaît d’abord dans l’argot dans un contexte d’illégalité, où « travailler » signifie « voler » (1623), puis « assassiner » (1800) et « se prostituer » (1867)
Le sens communément admis de « avoir une occupation professionnelle » (sans que ce soit illégal) apparaît vers 1690 – après son premier emploi argotique, donc, mais s’installe pleinement plus tardivement.
Ce dernier sens aboutit après avoir servi dans des expressions plus spécialisées comme « travailler le fer » (1680), « travailler la pâte » en cuisine (1732), ou « travailler pour / contre quelqu’un » (1651) = le servir / le desservir.
travail apparaît peu après le verbe « travailler » (au XIIè siècle) et suit logiquement les évolutions sémantiques de ce dernier
♣ jusqu’à l’époque classique, il exprime couramment les idées de « tourment« , « peine« , « fatigue »
♣ l’idée moderne d’activité productive apparaît en moyen français (début XVè siècle) dans les domaines manuel et intellectuel, et signifie particulièrement « activité nécessaire à l’accomplissement d’une tâche » ainsi que « activité utile à l’homme que l’on impose aux animaux » (1668).
« travail » désigne ensuite la façon dont l’activité est accomplie (1690) et le résultat de cette activité.
Au XIXè siècle, il désigne l’activité humaine organisée à l’intérieur du groupe social et exercée régulièrement (1803)
Le nom « travailleur », désignant d’abord celui qui fait souffrir » et « qui veut du mal à » … prend la valeur moderne de « personne qui travaille » au XVIè siècle, se disant de toute personne faisant un travail utile, qu’il soit physique ou intellectuel.
C’est donc à la fin de ce long paragraphe que l’on tombe enfin sur un mot super important à mes yeux = UTILE
Parce qu’il rebondit sur ce que je disais en intro et amène un lot de questionnements, de contradictions, … La personne qui passe des heures dans sa cabine au péage de Trifouillis-les-Canards se sent-elle utile? Et la misérable paie que cela lui rapporte suffit-elle à subvenir à ses besoins? Se sent-elle avoir une place, sa place, dans la société des hommes en effectuant ce travail-là? Dois-je vraiment déplorer leur disparition, continuer à souhaiter, peut-être pour mon confort personnel, que des gens se sentent pris dans un carcan de « bonjour, 1 euro 50 s’il vous plaît, merci, aurevoir »? Ces postes-là fabriquent-ils du lien? Ont-ils un sens?
Je finirai avec l’anecdote suivante vécue par un copain fin Septembre (et aussi par une copine à la même période).
A. arrive à l’un de ces petits péages de la région et introduit sa carte bancaire dans la machine. La carte ressort, sans affichage ni reçu et la barrière reste baissée. Il recommence : même scénario. Pensant la machine en panne, il prend une pièce de 2 euros, la balance dans le panier et attend la monnaie. Pas de monnaie, la barrière reste baissée. Il se dit qu’il a dû se tromper et mettre une pièce de 1 euro ; il en balance une autre, de 2 euros. Rien.
Il appuie sur le bouton permettant de rentrer en contact avec une personne, explique son problème et s’entend répondre : « C’est normal, Monsieur, qu’elle vous rende pas la monnaie, vous avez déjà payé deux fois avec la carte bancaire! Comment? Ah non, je ne peux rien faire, je ne peux pas quitter mon poste, mais je peux faire lever la barrière. Aurevoir Monsieur! »
8 euros pour l’usager au lieu de 1,40 euros / au moins deux postes de « gardiens de péage » supprimés
A part le maximum de fric dégagé pour la société qui gère ces péages … où est l’avancée en termes d’humanité?
Où est le bénéfice pour l’homme?
Ah, si, dernière question : laquelle de toutes ces significations appliqueriez-vous à votre propre activité ou à votre vision du travail?
*
11 octobre 2008